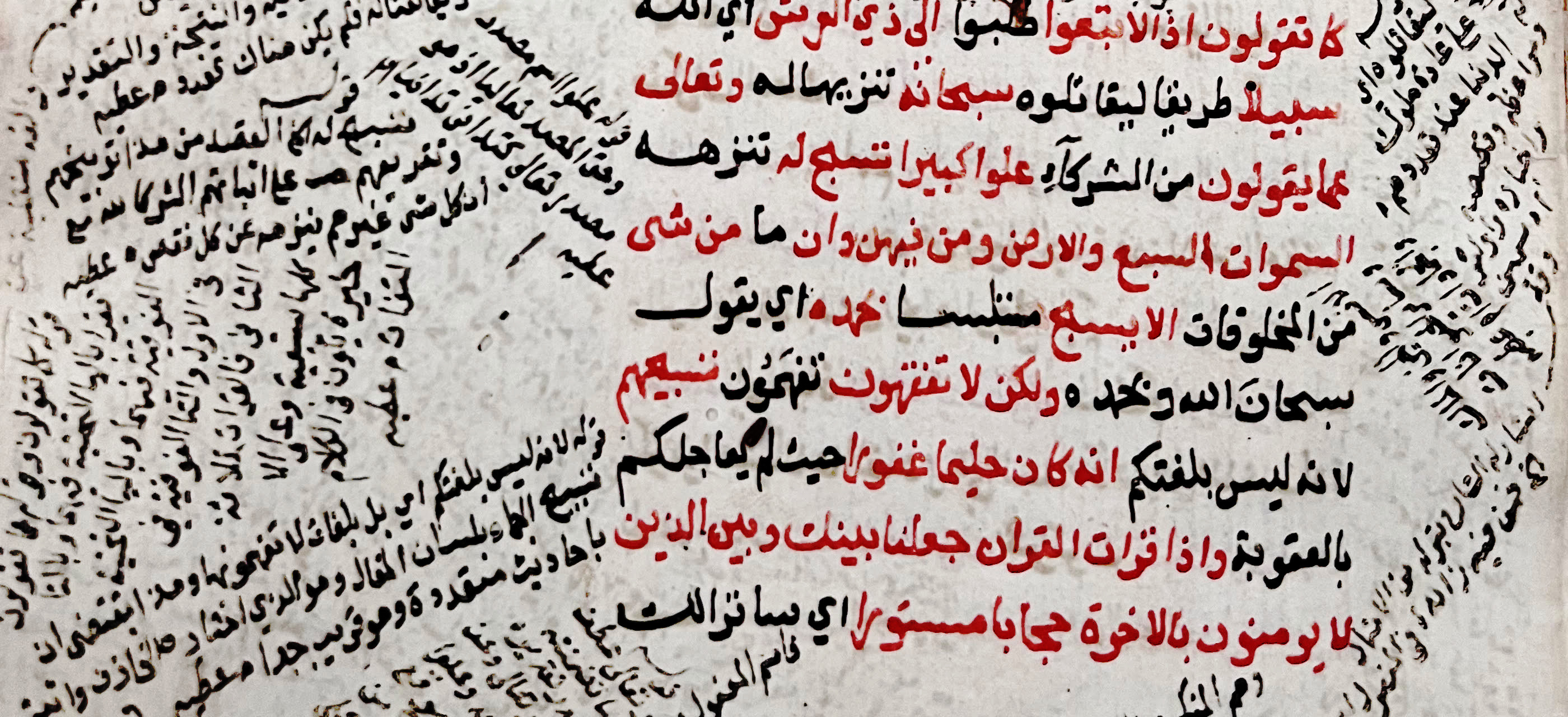Hégémonie, esclavage et modélisation des discours de domination sous les premiers empires au Proche-Orient médiéval
Contenu
- Titre
- Hégémonie, esclavage et modélisation des discours de domination sous les premiers empires au Proche-Orient médiéval
- Créateur
- Trabelsi, Salah
- Sujet
- Ibn Kaydad
- Résumé
- Les victoires remportées par les Arabes sur les deux grands Empires perse et byzantin se sont soldées par l’annexion d’immenses territoires. Ces conquêtes soudaines et fulgurantes ont bouleversé les équilibres sociaux et institutionnels des vieilles cités de la péninsule Arabique. Un des effets inhérents à la conquête est la montée en puissance d’une oligarchie militaire arabe qui, aidée par ses affidés parmi les notables des pays vaincus, confisqua à son profit les biens et les terres, ceci entraînant une brusque recrudescence des violences et des exactions. Dans ce contexte, les populations colonisées furent souvent réduites à l’état de bêtes brutes, dénuées de sensibilité humaine. En plus du mépris et des catégorisations raciales, elles furent frappées d’exclusion en vertu d’une politique d’oppression et de spoliations massives et systématiques.Ces transformations profondes apparurent dès la deuxième moitié du viie siècle. Une de leurs conséquences décisives est la naissance d’un puissant empire édifié par les califes omeyyades. Descendant des notables affiliés au clan mecquois des ʿAbd S̲h̲ams, ces dynastes régnèrent à Damas entre 661 et 750 apr. J.-C. Après leur chute, ce fut au tour de leurs rivaux, les Abbassides, d’imposer leur domination depuis Bagdad sur des peuples et des territoires répartis sur des côtes aussi diverses que celles de la mer d’Arabie, du golfe Persique, de la mer Rouge, de la Méditerranée et des deux océans Atlantique et Indien.Cet article entend fournir une analyse historique et critique des rapports sociaux, économiques et culturels au Proche-Orient médiéval, à une époque marquée par la naissance et l’apogée des deux premiers empires coloniaux arabes. L’un de ses principaux enjeux est de sortir d’une histoire édifiante pour retrouver une approche méthodique, permettant de comprendre les mouvements profonds d’une si longue histoire. Il s’agit d’une démarche qui privilégie une relecture serrée des sources de première main et fait attention aux sens précis des mots et à la valeur informative des témoignages. Ces renseignements proviennent des documents de chancellerie, des dīwān ou bureaux des secrétaires royaux, des livres des impôts (Kharādj), des traités médicaux, des sources géographiques et littéraires, des annales historiques, etc. Ces corpus dont nous disposons sont sans doute assez réduits, incomplets et souvent laudatifs. Ils tendent généralement à édulcorer les réalités qu’ils décrivent. Il arrive néanmoins d’y trouver des indications significatives permettant de reconstituer la trame du réel. Ces données sont sans doute loin d’être sans défauts. Elles nous aident cependant à mieux cerner les faits pour les replacer dans l’infinie variété du réel tout en élargissant les champs d’investigation au sujet des discours sur l’altérité, de l’évolution des mentalités, de l’entrée en jeu des préjugés de couleur, des hiérarchies sociales et des identités biologiques et culturelles.
- Est une partie de
- Esclavages & Post-esclavages. Slaveries & Post-Slaveries
- numéro
- 11
- Date
- 2025
- Langue
- fre
- doi
- 10.4000/140oh
- issn
- 2540-6647
- Droits
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Position : 51947 (7 vues)